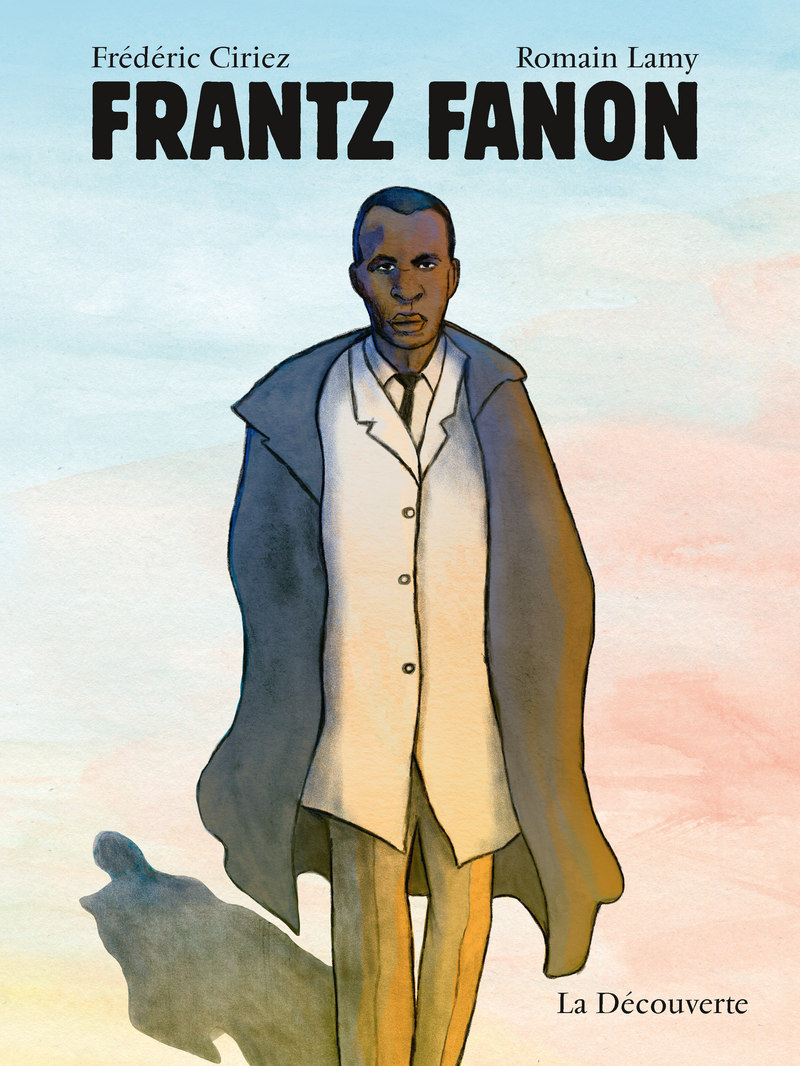(Billet en construction)
La Commune de Paris a 150 ans.
La Commune de 1871
C'est le nom qu'on attribue généralement au gouvernement
révolutionnaire français établi par le peuple de Paris à la fin de
la guerre franco-prussienne (1870-1871). L'échec de la bataille de
Sedan scelle la défaite française et le 1er septembre 1870, l'empereur
Napoléon III se rend aux prussiens. Deux jours plus tard, les républicains
de Paris se saisissent du pouvoir et proclament la 3ème République,
reprenant la guerre contre la Prusse.
En janvier 1871, les français capitulent après un siège de Paris qui
dure plus de 4 mois. Les termes de l'armistice signé en février prévoient
la tenue d'un vote de l'Assemblée Nationale sur l'éventualité de conclure
une paix avec les prussiens. La majorité des députés - des royalistes
qui veulent restaurer la monarchie - sont partisans de l'approbation
des conditions de paix imposées par le premier ministre de Prusse,
Otto von Bismarck. Les républicains radicaux et les socialistes toutefois,
refusant d'accepter les conditions d'une paix qu'ils ressentent comme
une humiliation, sont en faveur de la poursuite du conflit.
Les 17 et 18 mars, la population parisienne se soulève contre le gouvernement
national qui est contraint de fuir la capitale pour venir s'installer
à Versailles. A Paris, les radicaux installent un gouvernement "prolétaire"
qu'ils nomment Comité Central de la Garde Nationale et fixent la date
du 26 mars pour la tenue d'élections au Conseil Municipal. C'est sous
le nom de "Commune de 1871" que ce Conseil et ses membres, "les communards",
jouiront de leur plus grande notoriété. Un grand nombre de ces "communards"
sont des disciples de Louis Auguste Blanqui, révolutionnaire détenu
à Versailles sur instruction du chef de l'Assemblée Nationale, Adolphe
Thiers. D'autres se réclament de divers courants de l'école socialiste,
notamment les disciples de Pierre Joseph Proudhon et les membres de
l'Association Internationale des Travailleurs dont Karl Marx est à
l'époque le secrétaire correspondant.
La Commune promulgue un grand nombre de mesures en faveur des ouvriers,
mais ne vivra pas assez longtemps pour que celles-ci puissent entrer
en vigueur. En effet, le gouvernement de Thiers est décidé à étouffer
l'insurrection par la force. (...)
Extrait du site du Rebond pour la Commune.
Chronologie de l’histoire de la Commune, par Michèle Audin.
Michèle Audin (Alger, 1954) est une mathématicienne française dont les recherches concernent la topologie algébrique et la géométrie symplectique. Audin, Alger... oui, en effet, elle est la fille du mathématicien Maurice Audin, un mort (sous la torture) par la France.
Elle est aussi écrivaine, et oulipienne, et une connaisseuse majeure de la Commune : une référence essentielle en la matière. Elle dispose d'un blog incomparable et incontournable —touffu et détaillé comme tout— à son égard : Ma Commune de Paris. N'hésitez pas à y accéder, il est passionnant.
Autrice de cinq ouvrages sur le sujet, parus de 2017 à 2021, Michèle Audin vient justement d'en publier le cinquième...

La Semaine sanglante
Mai 1871, légendes et comptes.
« Il ne s’agit pas de se jeter des crimes et des cadavres à la tête, mais de considérer ces êtres humains avec respect, de ne pas les laisser disparaître encore une fois. »
La guerre menée par le gouvernement versaillais de Thiers contre la Commune de Paris s’est conclue par les massacres de la « Semaine sanglante », du 21 au 28 mai.
Cet événement a été peu étudié depuis les livres de Maxime Du Camp (1879) et Camille Pelletan (1880).
Des sources, largement inexploitées jusqu’ici, permettent de découvrir ou de préciser les faits.
Les archives des cimetières, que Du Camp a tronquées et que Pelletan n’a pas pu consulter, celles de l’armée, de la police, des pompes funèbres permettent de rectifier quelques décomptes : dans les cimetières parisiens et pour la seule Semaine sanglante, on a inhumé plus de 10 000 corps. Auxquels il faut ajouter ceux qui ont été inhumés dans les cimetières de banlieue, qui ont brûlé dans les casemates des fortifications, et dont le décompte ne sera jamais connu, et ceux qui sont restés sous les pavés parisiens, exhumés jusqu’en 1920…Avec cette étude implacable, Michèle Audin, grande connaisseuse de la Commune de Paris, autrice de Josée Meunier 19, rue des Juifs (Gallimard) et Eugène Varlin, ouvrier-relieur (Libertalia), rouvre un dossier brûlant.
264 pages — 10 €
Parution : 4 mars 2021
ISBN physique : 9782377291762
ISBN numérique : 9782377291779De la même autrice
aux éditions Libertalia
Le , sous le titre Lieux communs sur la Commune, Mathieu Dejean (site de Là-bas si j'y suis) nous propose un entretien de 44' avec elle. Dans sa présentation, il souligne justement que, dans ce bouquin, Michèle Audin met au jour les falsifications versaillaises pour masquer le massacre des insurgés [après avoir tout fait pour tuer le plus possible de communards], et dissipe des légendes abondamment relayées par l'Histoire officielle qui —soit dit en passant— a toujours préféré commémorer des personnages comme Napoléon, fabrique d'un imaginaire collectif oblige. Ce n'est pas par accident que la colonne Napoléon, place Vendôme, fut déboulonnée par les communards, avec la participation du peintre Gustave Courbet, le 16 mai 1871. Sa démolition s'imposait...
« La Commune de Paris, considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l’un des trois grands principes de la République française, la fraternité, décrète : article unique - La colonne Vendôme sera démolie.
(Décret du 13 avril 1781).
Et ce n'est pas non plus par hasard que, l'ordre rétabli, concrètement quatre ans plus tard, la colonne serait reconstruite sur ordre du maréchal royaliste et président de la Troisième République Patrice de Mac Mahon, comte de Mac Mahon et 1er duc de Magenta. Monuments et piédestaux sont le marbre des mythes et des splendeurs imaginaires qui doivent glorifier les noms des assassins et peupler l'imaginaire du peuple. Mêmes buts que les noms des rues, les livres d'Histoire, les pages de la presse libre et plurielle, les JT et j'en passe.
________________________________________
— D'autres billets Candide sur la Commune :
— Rétrospective Peter Watkins à Paris (2.12.2010).
— Charonne, le 8 février 1962... et la Commune de Pignon-Ernest (lundi 8 février 2021)
Ce billet contient le film La Commune, de Peter Atkins, en deux vidéos, et un entretien avec le réalisateur enregistré en 2001.
— Site des Ami.e.s de la Commune de Paris 1871. Bibliographie non exhaustive.
— Sur le site de la TSR ou sur le site des Mutins de Pangée... (je vous mélange leurs infos/contenus et mes remarques) :
La Commune, par Henri Guillemin
La Commune, par Henri Guillemin par lesmutins.org sur Vimeo.
Avec la précision d’un horloger helvète, Henri Guillemin décortique la trahison des élites, la bassesse des bien-pensants, la servilité des "honnêtes gens", la veulerie des dominants tout autant que les raisons qui entraînèrent le Peuple de Paris à la faillite.
Il faut rendre aussi hommage à Henri Guillemin (Mâcon, 1903-Neuchâtel, 1992), historien incisif, hétérodoxe, passionnel et pamphlétaire, spécialiste du XIXe siècle et critique littéraire. C'était un grand contempteur et démystificateur de « l’histoire bien-pensante », grand moteur de sa révision de l'Histoire, et il faut saluer concrètement son effort de précision et de divulgation à l'égard de la Commune, qu'il exposa talentueusement, à partir de son « Salut ! » de démarrage, dans la sobriété monacale d'un studio de la Télévision Suisse Romande, en 1971, centenaire de cette épouvantable tragédie. Il était banni des télévisions française et belge, mais il put heureusement s'épanouir sur la TSR, où il disposa, entre autres émissions, des Dossiers de l'Histoire, séries de conférences sur des sujets historiques ou littéraires.
Le 21 novembre 2018, Les Mutins de Pangée lancèrent un très soigné coffret réunissant en trois DVD les 13 leçons sur La Commune de ce superbe conteur-historien, et son bouquin Réflexions sur la Commune, publié pour la première fois par Gallimard, dans la collection La Suite des temps, en 1971. Une seconde édition à l'identique était parue aux Éd. d'Utovie en 2001, qui coéditent cette 3e édition (corrigée et enrichie) avec Les Mutins.
Ce livre de 240 pages inclut également des dessins de Jacques Tardi tirés des 4 volumes de sa saga Le Cri du peuple (Éd. Casterman, premières édition de 2001, 2002, 2003 et 2004 respectivement), adaptation du roman homonyme de Jean Vautrin (Grasset 1999), qui avait à son tour emprunté le titre au journal éponyme fondé par Jules Vallès, avec des collaborateurs comme Jean-Baptiste Clément ou le proudhonien Pierre Denis, et paru pour la première fois le 22 février 1871.
Le premier des trois DVD offre en prime deux compléments. D'abord, la vidéo Henri Guillemin, par Patrick Berthier (17' - Les Mutins, 2018) ; puis Si on avait su (13', ISKRA, 1973), court-métrage d'animation de Stanislas Choko.
Henri Guillemin déroula son plan de révision de l'histoire de la Commune en 13 volets, proposés à la télévision du 17 avril au 30 octobre 1971. Il expliqua qu'il convenait d'abord de remonter à la Révolution française pour comprendre cette histoire atroce. Ces 13 séquences étaient, donc, dans l'ordre : La Révolution française - Qui est Thiers ? - La Guerre de 1870 - Le siège de Paris - L’avant-Commune - À Versailles - Ambiance à Paris (capitale assiégée) - Des gens scrupuleux (Les gens de la Commune) - La vrai France en action - À l’attaque de Paris - Le moment de vérité (La victoire des "honnêtes gens") - Le fond des choses - Lendemains.
"Ce qui m’émeut, dans la Commune, ce qui m’attachera toujours à elle, c’est qu’on y a vu des gens, à la Delescluze, à la Rossel, à la Vallès, à la Varlin (celui-là surtout, quelle haute figure, bouleversante), des hommes qui ne "jouaient" pas, qui risquaient tout, et le sachant, des courageux, des immolés. Parce qu’ils avaient une certaine idée du Bien et qu’ils y vouaient leur existence même."
Henri Guillemin, Journal de Genève, 22 avril 1965
IMAGES À TÉLÉCHARGER
— Site d'ARTE : la chaîne franco-allemande nous propose un film d'animation très récent et prodigieux...
Les Damnés de la Commune, réalisé par Raphaël Meyssan —enfant de Belleville et complice de Michèle Audin : J’avoue me sentir très proche, non des moyens graphiques utilisés, bien sûr, mais de la façon qu’a Raphaël d’aborder l’histoire, celle de « ceux qui n’étaient rien », a-t-elle écrit.
Sorti en 2019, disponible en ligne sur ARTE du 16/03/2021 au 19/08/2021, ce documentaire dure 88'.
Le 23 mars, Alain Constant a écrit dans Le Monde :
(...) En utilisant uniquement des gravures d’époque, mais animées grâce à des effets bluffants, jouant notamment sur la profondeur (les oiseaux volent, la neige tombe, les obus explosent, les flammes dansent…), le graphiste Raphaël Meyssan, accompagné par le scénariste Marc Herpoux, les monteurs du studio d’animation Miyu et les compositeurs Yan Volsy et Pierre Caillet, met en scène un formidable rendez-vous avec l’histoire de la Commune de Paris, si rarement exposée sur les écrans.
Auteur d’une BD ambitieuse intitulée Les Damnés de la Commune (Delcourt, 2017-2019) – trois gros tomes retraçant, à l’aide d’images d’archives, l’histoire aussi brève que sanglante des événements survenus à Paris entre fin mars et mai 1871 –, Raphaël Meyssan a travaillé de longues années pour amasser des milliers de documents d’époque. (...)
Pour adapter 500 pages à l’écran, il fallait faire des choix. La bonne idée de l’auteur est d’avoir choisi Victorine Brocher comme fil rouge de son premier long-métrage, l’un des personnages importants de sa BD et dont les Mémoires, Souvenirs d’une morte vivante, l’avaient bouleversé, dit-il. Cette mère de famille « au destin exceptionnel » s’engagera avec fougue dans la Commune de Paris, y perdra son très jeune fils puis son mari, mort au combat. Intégrant le bataillon Les Enfants perdus, échappant de peu au massacre, Victorine s’exilera en Suisse, où elle adoptera des orphelins du mouvement communard avant son retour en France, après l’amnistie de 1880.La force de ce documentaire tient aussi aux soins apportés par l’équipe technique aux bruitages et à une bande-son (trompettes, violons) de qualité. Sans oublier un casting vocal de haute volée : tout au long du film, les voix de Yolande Moreau (Victorine) et de Simon Abkarian (le narrateur) prennent aux tripes.
A ces deux voix puissantes et parfaitement calibrées s’ajoutent celles de Mathieu Amalric (Adolphe Thiers), Fanny Ardant (la mère de Victorine), Charles Berling (Gustave Courbet), Sandrine Bonnaire (Louise Michel), Denis Podalydès (Georges Clemenceau), André Dussolier (le sauveur de Victorine) ou Jacques Weber (Victor Hugo), pour ne citer que les artistes les plus connus. (...)
La BD Les Damnés de la Commune, projet avant-coureur du film, est composée de trois tomes (Éd. Delcourt 2017-19) : À la recherche de Lavalette (8.11.2017), Ceux qui n'étaient rien (13.03.2019) et Les orphelins de l'histoire (6.11.2019). Toute la presse a plané et salué en chœur la prouesse de son délire.
Les yeux toujours pétillants de pure joie, Raphaël Meyssan explique ici d'une manière très détaillée sa démarche, d'abord pour la confection de son fascinant roman graphique, ensuite pour la réalisation d'un film pas comme les autres.
Le film démarre en 1867, lorsque l'Exposition universelle de Paris vient de fermer ses portes (le 3 novembre). Paris devient un paradis... pour les riches. Mais les loyers augmentent et les pauvres se voient repoussés vers la périphérie : ils s'entassent dans les faubourgs...
Comme l'explique Alain Constant un peu plus haut, la perspective et la voix narratrice de cette construction historique découlent des souvenirs publiés à Lausanne en 1909 par Victorine Brocher (1839-1921), une énorme petite communarde (mesurant 1,52 m de taille) qui avait tout perdu sauf la vie. C'est la comédienne et réalisatrice bruxelloise Yolande Moreau qui lui prête sa voix sur les gravures et les dessins. Elle se présente ainsi dans le film :
« Je m’appelle Victorine et j’ai grandi dans la nuit du Second Empire. Depuis mes 14 ans, j’ai fait de nombreux métiers : j’ai été crieuse de journaux, porteuse de pain, marchande de soupe, lavandière, couturière... Je travaille 12 à 14 heures par jour pour un salaire dérisoire. J’habite au pied de la butte Montmartre avec mon mari. C’est un ancien soldat. Je ne peux compter que sur moi-même. »
Elle sera cantinière, puis ambulancière des Enfants perdus, un bataillon de fédérés...
(...) Raphaël Meyssan a adapté les trois tomes de son roman graphique éponyme, pour lequel il avait collecté des centaines de gravures dans les journaux et les livres de l’époque. De cette patiente quête d’archives − huit ans de recherches −, le graphiste et réalisateur tire un film unique, à l’esthétique et au dispositif étonnants. La caméra plonge au cœur de ces dessins magnifiques, émouvants et subtilement animés, puis zoome, scrute et caresse pour restituer cette tragique épopée dans le moindre de ses détails en une fresque prodigieuse. À mi-chemin entre Les misérables de Victor Hugo et les bandes dessinées documentaires de Joe Sacco, Raphaël Meyssan compose, en incluant le récit de Victorine, une jeune révoltée, une narration limpide qui parvient, à destination de tous les publics, à rendre fluide le chaos de la Commune. Une réussite.
— France Culture : Thème - La Commune de Paris.
— France Inter (le 18.03.2021) : Laure Godineau et Quentin Deluermoz (Faut-il célébrer les 150 ans de la Commune ?). L'Histoire de la Commune en 6 minutes, sur ARTE, par Laure Godineau.
— Contretemps (revue de critique communiste) : La Commune au jour le jour, par l'historien Patrick Le Moal.
À l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris, Contretemps publie du 18 mars au 4 juin une lettre quotidienne rédigée par Patrick Le Moal, donnant à voir ce que fut la Commune au jour le jour.
_______________________________________
Jean Ferrat : La Commune (1971)